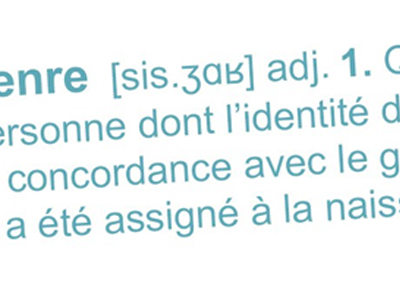Orthotypolitique : tout est politique, la grammaire et l’orthographe aussi !
Ce post a été publié en 2018 et peut contenir des informations dépassées ou des opinions que je ne partage plus aujourd'hui.
En septembre dernier, pour fêter le premier anniversaire du magazine, nous avions publié un bilan chiffré de cette première année d'existence ainsi qu’un retour d’expérience sur la création d’un magazine from scratch.
Aujourd’hui, nous vous proposons un retour sur le projet fil rouge qui a occupé quelques membres de l’équipe pendant une bonne partie de l’année : le chantier orthotypo.

Illustration réalisée pour Simonæ par le fabuleux Wicked Clarence.
L’orthotypo, quésaco ?
Derrière ce nom étrange se cachent deux faces de la correction, l’orthographe et la typographie, qui, une fois combinées, donnent l’orthotypographie, ou l’ensemble des règles permettant d’écrire de façon correcte.
Ce sont ces règles qui déterminent, par exemple, comment placer les signes de ponctuation dans une phrase (pas d’espace avant une virgule, une espace avant et après les ponctuations doubles, etc.). Chez Simonæ, notre ouvrage de référence est le Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale, adapté pour le français non sexiste, bien entendu.
Tout a commencé par une volonté de reprendre certains anciens articles dans lesquels nous avions laissé passer quelques fautes, et d’harmoniser le site au niveau de certains choix typographiques. Nous devions passer quelques heures à corriger tout ça, et c’est tout.
Nous avons finalement décidé de mettre à profit cette repasse générale pour optimiser et harmoniser nos choix orthotypographiques, mais également pour corriger le fond des articles quand c'était nécessaire et pour reprendre l’ensemble des mises en page.
En effet, en deux ans, nos connaissances et nos opinions ont évolué et nous sommes désormais davantage compétent·es sur certains sujets, ce qui nous a amené·es à reconsidérer certains de nos articles et à en retravailler lourdement d’autres. La ligne éditoriale du magazine s’est affinée, et si nous mettons toujours un point d’honneur à garder nos articles accessibles à tou·tes, avec ou sans connaissances préalables, nous tendons désormais vers un contenu plus pointu, plus sourcé et détaillé.
Des quelques heures en dilettante imaginées, nous sommes donc passé·es à plusieurs mois de travail acharné.
Il y a presque 600 articles publiés sur Simonæ et chacun de ceux qui ont été retravaillés par l’équipe chantier est passé par ces étapes :
- relecture de fond et orthographique + harmonisation orthotypographique + suppression ou remplacement des liens morts + ajout de sources le cas échéant, par une personne, en lien avec læ ou les auteurice(s) de l’article ;
- relectures complémentaires par deux voire trois autres personnes ;
- choix des « liens internes » à intégrer à l’article, c’est-à-dire des liens « À lire aussi » renvoyant vers nos autres articles (cf. la capture d’écran ci-dessous) ;
- choix des phrases à mettre en exergue (cf. la capture d’écran ci-dessous) ;
- nouvelle mise en page sur le site, avec éventuellement de nouvelles illustrations ;
- dernière relecture, directement sur le site, pour vérifier que tout est parfait.
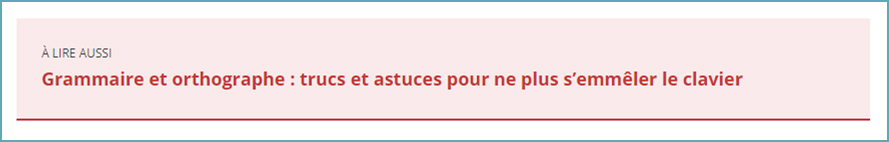

Les mille visages du français non sexiste
Le français épicène [1], ou français non sexiste, peut s’écrire de multiples façons. À l’aide de parenthèses, de majuscules, de barres obliques, de points, d’apostrophes, de points médians, de puces, de tirets… Il en existe presque autant de variantes que d’adeptes, puisqu’il se développe de façon non officielle, en fonction des usages. Ces différentes graphies n’ont pas la même portée politique et sont plus ou moins accessibles.
Dès le lancement du magazine, parmi les multiples caractères utilisés, notre choix s’est porté sur le point médian, pour des raisons que nous avons exposées ici. Nous avons également décidé d’utiliser des mots-valises sur les terminaisons qui s’y prêtent, en écrivant par exemple « nouvelleaux » ou « illustrateurice ».
Les mots-valises, s’ils peuvent choquer au premier abord, présentent des avantages remarquables pour le français non sexiste. Tout d’abord, pour une question d’accessibilité : en fusionnant les terminaisons masculines et féminines, on évite le recours trop récurrent au point médian, qui peut rendre la lecture plus difficile pour les personnes dyslexiques, par exemple, ou bien pour les synthèses vocales (utilisées par les personnes aveugles ou malvoyantes). D’un point de vue idéologique, l’emploi des mots-valises est également important puisqu’il présente un intérêt pour l’usage oral. Nous privilégions donc au maximum les tournures prononçables.
Nous utilisons la forme neutre dès que nous parlons d’une personne dont le genre n’est pas déterminé, d’une personne non binaire, ou d’un groupe comportant des personnes de genres différents. Il y a une seule exception à cette règle : nous écrivons toujours « agresseur » et « violeur » au masculin, sauf dans le cas spécifique où l’auteurice d’une agression ou d’un viol n’est pas un homme. Il s’agit d’un choix politique, pris pour refléter la réalité de la démographie des agresseurs et des violeurs, en immense majorité des hommes, ainsi que l’influence du patriarcat (c’est un problème systémique et non individuel).
Nous avons, à l’occasion du chantier, apporté une modification à notre type d’écriture non sexiste, pour la rendre plus légère à la lecture : dans le cas d’un pluriel, nous ne répétons plus le point médian. Ainsi, au lieu d’écrire « tou·te·s les étudiant·e·s », nous écrivons « tou·tes les étudiant·es ».
Un autre point sur lequel nous avons dû prendre des décisions, ce sont les mots à orthographe multiple. Dans le cas où plusieurs graphies sont acceptées pour le même mot, nous voulons autant que possible utiliser la même partout, par souci d’harmonisation.
Étant donné que nous avons deux correctrices professionnelles dans l’équipe et qu’elles doivent utiliser l’orthographe pré-réforme dans leur travail quotidien, nous avons choisi de nous y tenir également, pour leur éviter de devoir basculer de l’une à l’autre en fonction du contexte. Nous avons cependant fait quelques exceptions : par exemple, « nénufar » est plus proche de son origine arabo-persane que « nénuphar ».
Ce qui nous amène au point suivant.
Orthotypolitique
L’orthographe et la grammaire sont politiques. On pense à l’écriture non sexiste, bien entendu, mais ça va plus loin. Tout est politique, rien n’est neutre (et la position, en apparence neutre, qui consiste à ne rien changer à l’ordre établi, n’est pas apolitique, mais conservatrice), et les choix orthotypographiques n’échappent pas à la règle.
L’orthographe et la grammaire sont politiques.
On n’y prête pas toujours attention, mais une majuscule ou un trait d’union peuvent en dire long sur notre appréhension de la réalité. Par exemple, il est d’usage d’écrire les termes d’origine étrangère en italique, parce qu’il fait ressortir naturellement un mot dans un texte en romain. Il est utilisé pour signaler à læ lecteurice que son code de lecture va changer, en opposition au reste du texte. C'est donc loin d'être un choix anodin.
Nous appliquons donc l’italique à des mots étrangers comme a priori, pour lequel nous avons choisi de conserver la graphie latine, ou badass, emprunté à l’anglais. En revanche, choisir d’écrire « queer », « coming out » ou « burqa » en italique parce que ce sont des mots issus d’une autre langue revient à les « exotiser », à marquer qu’ils ne sont pas la norme, qu’ils ne font pas partie du français. Et donc des pays francophones. Nous avons choisi de ne pas mettre ces mots en italique et, comme nous considérons qu’il s’agit de mots de la langue française, nous les accordons en genre et en nombre le cas échéant. C’est une position politique.
Une majuscule est également lourde de sens. Le cas le plus flagrant concerne la graphie du substantif « noir·e », que l’on rencontre la plupart du temps avec une capitale dans la presse. La règle grammaticale est simple. Si l’on prend le Lexique des règles typographiques, on lit : « Prennent la capitale initiale les noms de peuples, de races et d’habitants employés substantivement. » Le Lexique nous donne même des exemples de noms d’habitants (les Chinois, les Russes) et de races (les Noirs, et… les Jaunes).
Si la majuscule au substantif « noir » est choquante, c’est parce qu’elle suit une règle grammaticale problématique : on met une majuscule aux noms lorsqu’ils désigne une personne sur des critères géographiques, ou de couleur de peau (Le Bon Usage de Grévisse) ou de race (le Lexique des règles typographiques). Cela sous-entend donc que la couleur de peau renvoie automatiquement un·e individu·e à un groupe, une communauté. Or, comme l’explique le site Une autre histoire, « dire qu’un[·e] individu[·e] appartient à un groupe par la seule couleur de sa peau, c’est la définition même du racisme ». Nous écrivons donc « un·e noir·e », sans majuscule (ceci dit, « une personne noire » reste préférable, cf. plus bas).
[TW : mention de pédocriminalité]
Nous avons également récemment changé notre vocabulaire concernant la pédocriminalité :
- le mot « pédopornographique » implique qu’il s’agit d’une sorte de pornographie comme une autre, et occulte complètement la dimension violente et non consentie des images et des vidéos concernées. Nous utilisons donc le mot « pédocriminel·le » ;
- de même, le mot « pédophile » étant construit avec le suffixe -phile, du grec phílos (« ami, personne qui aime »), il est totalement inadapté. Nous le remplaçons également par « pédocriminel·le » ;
- enfin, nous ne parlons pas d’« abus » mais de « violences » et pas d’« attouchements » mais d’« agressions ».
Nous prêtons également une attention particulière aux noms que nous utilisons pour les personnes et les mouvements. Nous refusons par exemple d’appeler les personnes contre le droit à l’avortement les « pro-vie ». Nous les appelons les « anti-choix ».
De même, nous avons pris un certain nombre de décisions concernant les termes utilisés pour désigner les pays et les peuples :
- nous parlons de Daesh et non pas de l’État Islamique ;
- nous parlons d’extrême droite ou de neo-nazi et non d’alt-right ou ultra-droite ;
- pour désigner une chose venant des États-Unis d’Amérique, nous employons « états-unien·ne » et non « américain·e », pour arrêter de résumer un continent entier à un seul de ses pays ;
- nous utilisons autant que possible les termes approuvés par les peuples pour les désigner. Ainsi, nous parlons de « premières nations » et non d’« amérindien·nes », et nous excluons totalement l’usage du terme « Eskimo » pour désigner les peuples inuits et yupiks, car il est très insultant ;
- nous parlons de « femmes qui portent le voile » et non pas de « femmes voilées », ou pire, de « voilées ». De la même manière, nous parlons d’« hommes trans », de « personnes bisexuelles », etc. ;
- de manière générale nous optons autant que possible pour les mots choisis ou préférés par les personnes concernées.
Bien entendu, cette liste est amenée à évoluer.
Nous féminisons les noms de métiers – tous. Si une forme existe au masculin, cela veut dire qu’elle peut être déclinée au féminin, selon les règles de dérivation, ou de l’usage. Nous tentons d’ailleurs d’utiliser au maximum les formes grammaticalement correctes, mais « tombées en désuétude », comme « autrice », « peintresse », etc. La plupart de ces termes étaient d’ailleurs couramment utilisés à la Renaissance, mais ont disparu vers le XVIIe siècle. Les historien·nes imputent cet effacement à une reprise en main politique du langage par les hommes. Avec la création de l’Académie en 1635, les académiciens (alors exclusivement des hommes) ont voulu renforcer la domination masculine en supprimant la féminisation de certaines fonctions prestigieuses, jugeant les femmes impropres à leur exercice. Exit donc philosophesses, autrices, poétesses, etc. D’autres ont même récupéré une connotation péjorative, comme « peintresse », utilisé au XXe siècle pour déprécier les femmes qui peignaient. De la même façon, les mots comme « médecine » ou « médecienne » ont disparu au moment où l’on a décrété que le savoir médicinal ne pouvait appartenir qu’aux hommes. Il est donc important de se réapproprier ces termes, de les remotiver et leur rendre leurs lettres de noblesse.
Il n’y a pas que les noms de métiers féminins qui tombent en désuétude. Des termes comme « quelqu’une », que l’on peut retrouver chez Verlaine, Proust ou Maupassant, ont également disparu du langage courant. D’autres, comme « individue », sont signalés comme incorrects par beaucoup, alors que le mot existe bien sous la forme adjectivale dans les dictionnaires. Ces mots ne sont pas des fautes de français, ils font partie de notre langue et nous n’hésitons donc pas à les utiliser dans nos articles.
Concernant l’appellation « grammar nazi » :
- l’utilisation du terme « nazi » à des fins humoristiques nous paraît au mieux de très mauvais goût et au pire franchement problématique ;
- le comportement prêté aux « grammar nazis » est classiste et validiste.
Vous accordez de l’importance à l’orthographe, la grammaire et la syntaxe ? Chouette ! Mais ne mêlez pas une idéologie politique d’extrême droite, à l’origine d’un génocide, à vos batailles de conjugaison, ça n’a rien à voir. Et arrêtez de juger les gens sur leur façon de s’exprimer.
Un dernier point : si nous faisons très attention au vocabulaire que nous utilisons dans nos articles, nous sommes convaincu·es qu’il est important de ne pas discréditer complètement un discours à cause d’un terme mal choisi et de partir dans une guerre de mots.
Mieux vaut un article réfléchi avec quelques mots imparfaits qu’une utilisation sans recul des termes certifiés militants © sans maîtrise de ce qu’ils désignent. De la même manière, nous ne reprenons pas les personnes concernées sur les termes qu’elles choisissent d’utiliser. Il nous paraît complètement déplacé, par exemple, d’expliquer à une personne trans qu’elle ne peut pas se désigner elle-même en tant que « transexuelle » parce que « c’est pas le bon terme », quand bien même elle aurait fait sa transition (et adopté les mots pour décrire son identité) avant l’apparition (ou l’adoption) de la plupart des termes utilisés actuellement. Chacun·e est libre de choisir le terme qui correspond le mieux à son vécu.
Ce que l’on peut retenir de ce chantier, et des articles publiés sur Simonæ en général, c’est que la forme compte autant que le fond. Le militantisme passe aussi par un travail sur les mots, car « le langage structure et oriente notre pensée ». Il n’est pas, comme le pensent à tort les fameuxes défenseureuses de la langue française, figé, mais il ne cesse au contraire d’évoluer avec la société. Le discours traduit dans sa forme les oppressions et les systèmes de domination ; il ne faut donc pas hésiter à en modifier les règles pour adapter la forme au fond de son message. Qu’on le veuille ou non, tout est politique, rien n’est neutre.
Nous espérons, grâce à ce chantier, au soin apporté à nos articles et à ces deux années de travail collectif, avoir fourni des clefs pour comprendre les oppressions, l’importance de l’intersectionnalité dans les luttes et de la représentation dans les médias. Nous avons encore beaucoup de choses à (vous faire) découvrir, merci à tou·tes de nous suivre !
Notes de bas de page
[1] On parle de français ou de langage, et non pas d’écriture, parce qu’il n’y a pas de raison pour que les règles d’orthographe non sexiste ne s’appliquent qu’à l’écrit. C’est la langue française toute entière qui doit être mise à jour.